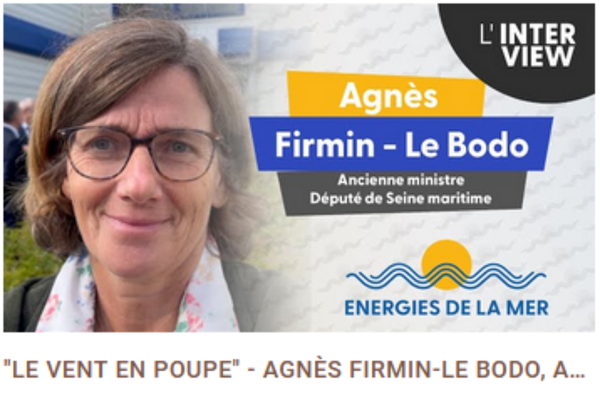France Québec – 17/10/2025 – energiesdelamer.eu.
Opinion de Pascale Legué, Anthropologue, membre de LittOcean
La diversité des interventions au cours de ces deux jours des Océanes Atlantique au Pouliguen (6-7 octobre 2025) nourrit la réflexion au sujet de la fragilité des mondes aquatiques, le littoral et la mer, et non les mers comme cela a été souligné au cours des débats, mais aussi ce futur, sujet des incidences que l’univers terrestre provoque sur ces espaces.
Il ressort des présentations des spécialistes présents qu’il est urgent d’engager des réflexions en perspective d’actions. Les participants à ces deux jours ont une conscience totale du péril que le monde aquatique et terrestre vit tant au présent que dans le futur.
En revanche, on peut craindre que cette fragilité maritime et côtière ne soit pas encore perçue par la majorité de la société française. Deux étudiants, Antoine Gabriel et Steeve Revignet[1] ont fait part de leur intérêt pour le sujet et surtout ont dessiné l’ensemble des manquements qu’ils percevaient à travers une enquête dans la société française dans sa globalité. Cette enquête a été réalisée auprès des intervenants des Océanes Atlantique 2024 et des élus de communes des régions Bretagne et des Pays de Loire impliquaient dans l’étude complémentaire commandée par le débat public « La Mer en débat« .
Bien sûr, quelques sites comme l’île d’Yeu agissent au vu des risques que la mer fait vivre ou va faire vivre à l’île. L’association … avec ses réunions régulières incitent les habitants annuels et les propriétaires de résidence secondaire à acquérir une connaissance claire et réfléchie du sujet et ainsi à s’inscrire dans une perspective d’action.

Collège Jules-Verne-au Pouliguen, Norbert Samama maire du Pouliguen, Isabelle Reboisson et Christelle Capel, respectivement Principale Collège Jules Verne et professeure d’histoire-géographie
Des élus et enseignants comme au Pouliguen (Christelle Capel) engagent aussi cette réflexion avec des collégiens de la 6e à la 3e dans un projet d’Aire marine éducative et invitant les 5e et 4e sur le terrain. » Cette démarche pédagogique et éco-citoyenne a pour but de sensibiliser le jeune public à la protection du milieu marin mais également de découvrir ses acteurs « .
Avec les Petits débrouillards[2], cette sensibilisation aux questions environnementales est aussi engagée.
On peut supposer que cet apprentissage des milieux marins est un acquis de connaissances pour ces jeunes, mais aussi de façon indirecte pour les adultes qu’ils côtoient au quotidien, famille, enseignants….
Toutefois, cette sensibilisation auprès de quelques jeunes demeure incomplète comparée à celle engagée par les Québécois. Ainsi, des écoles d’été ont été mises en place pour former les enseignants à ces questions palliant ainsi les craintes de ces derniers à aborder ce sujet du fait de leurs faibles connaissances.
Comparer les actions menées dans d’autres pays face à une problématique est toujours riche d’enseignement. Cette réflexion se fonde sur une transformation urbaine en zone côtière au Québec présentée par Jean-François Fortin le maire de Sainte-Flavie porte d’entrée de la Gaspésie, et un regard croisé par Floran Augagneur[3] et Sylvie Mondor[4], respectivement vice-président de la CNDP et directrice de l’environnement du BAPE. Une condition première fut posée : la consultation du public (BAPE) sur les projets donnant droit aux citoyens d’accéder à l’ensemble des informations lors de séances publiques leur offrant les renseignements essentiels à leur compréhension des enjeux. La participation des habitants fut importante (plus de 80 %). Les rapports du BAPE font partie des éléments pris en compte par le ministre responsable de l’Environnement afin d’éclairer la prise de décision gouvernementale.

Session menée sous la présidence de Barbara Leroy du Cerema, Agnès Baltzer, Caroline Rufin-Soler, Jean-François Fortin
Sainte-Flavie, porte d’entrée de la Gaspésie
Cette commune longe le fleuve Saint-Laurent. En raison des changements climatiques, l’érosion côtière est importante et leur conscience des risques de submersion déjà vécus en 2010. Il fut proposé que les maisons à risque élevé soient déplacées et reconstruites dans la proximité du village d’origine.
Depuis 2024, une structure protège le village, c’est la plus grosse recharge de plage jamais réalisée au Québec. Longue de 1,5 kilomètre et haute de près de 5 mètres aux endroits où la plage est la plus basse, elle est composée de galets de rivière surmontés d’une vingtaine de centimètres de sable, soit environ 350 000 tonnes de sédiments. L’ouvrage a nécessité 22 000 voyages de camion. Les habitants se l’approprient progressivement.
Ce vécu de Sainte Flavie suppose que dans tous projets BAPE de transformation urbaine des acteurs » ordinaires « , citoyens, personnes travaillant dans les ports, etc. participent dès l’origine[5]. Surtout, que les autres acteurs, institutions, entreprises, mais aussi des scientifiques soient associés dès l’initiative de l’étude en lien constant avec les habitants.
Un retour d’expérience se doit d’être porté à connaissance de tous les acteurs intéressés afin aussi de penser l’avenir et son évolution.
Le recul du trait de côte est inéluctable et menace toujours puisque la résistance de cette structure aux mouvements maritimes est conçue pour résister trente à quarante ans. Ceci est largement signalé, analysé par les spécialistes et énoncé auprès des habitants.
Cette attitude invitant au partage des connaissances avec les habitants et les institutions publiques comme les sociétés privées en vue d’actions bâtis ou environnementales n’est pas encore totalement intégrée en France, tant en métropole qu’en Outre-mer, même si tous les acteurs présents au Pouliguen disent le souhaiter.
Il est nécessaire qu’une réflexion commune sur ce sujet se construise et qu’elle soit respectée par les institutions concernées.
La relocalisation de Miquelon (Saint-Pierre et Miquelon) menacée de submersion invite les entreprises au réemploi des matériaux. Les acteurs associatifs, politiques et économiques de l’archipel cherchent à institutionnaliser cette pratique. Néanmoins, la participation des habitants au projet contrairement à Sainte-Flavie est dessinée en amont par les institutions et entreprises et imposée aux résidents.
Ces menaces aquatiques sont d’autant plus signifiantes que les spécialistes des régions polaires présents décrivent comment s’opère la fonte des glaces et surtout l’accélération rapide de leur disparition. Les glaces fondent de plus en plus tôt et ont du mal à se reconstituer en hiver provoquant la montée des eaux des océans, entraînant aussi l’émission du méthane dans l’atmosphère, aggravant à son tour le changement climatique. Ces phénomènes ont un impact important sur les animaux et végétaux vivant dans ces régions. Le respect de l’océan à partir de maintenant peut-il freiner la montée des eaux ? Si ce n’est pas le cas, peut-être peut-on éviter de l’accentuer en évitant de nier les risques.
Les spécialistes en océanographie spatiale comme Stéphane Hardy[6] et Jérôme Benveniste[7] l’ont aussi explicité observant et analysant cette montée des eaux à l’aide de satellites. La lecture et les effets des phénomènes aquatiques sur la terre sont maintenant si détaillés qu’ils permettent de notifier précisément les impacts des flots sur les falaises et la terre grâce aux microsatellites.
Malgré nombre de résistances locales, nationales internationales, il est temps de réfléchir plus avant à l’installation des éoliennes à terre et en mer. Au Québec, un projet maritime sur le Saint-Laurent ne serait pas envisageable selon les spécialistes présents à l’inverse du terrestre. En revanche, dans nombre de régions européennes, il peut être réfléchi même si la distance entre l’installation en mer et les terres ne semble pas totalement résolue sur le plan technique (Oléron à 40 km de la côte et en eau profonde).
Les journées d’Océanes Atlantique au Pouliguen révèlent l’ampleur du sujet, les possibles axes de réflexion et d’action, et surtout, invitent tous les acteurs, dont les résidents et propriétaires de résidence secondaire, à travailler conjointement avec divers organismes concernés au regard d’un avenir littoral et maritime fragile.
[1] Enquête réalisée par ces étudiants en Master 2 de Nantes Université, sur les attentes des participants et intervenants aux Océanes Atlantique, sous l’autorité d’Agnès Baltzer, Sophie Pardo, et Thierry Guineberteau (Nantes Université, LETG, UMR6554, CNRS)
[2] Premier réseau national d’éducation populaire à la citoyenneté par la pratique de la science
[3] Maire de Sainte-Flavie
[4] Directrice de l’expertise environnementale, BAPE Québec – Bureau d’audiences publiques sur l’environnement
[5] En Angleterre, cette participation locale se dénomme Community participation. Ces projets de partenariat entrainent généralement des décisionnaires à s’engager auprès des habitants pour s’assurer de sa réussite future.
[6] Stéphane Hardy, Spécialiste OT – Arctus Québec
[7] Jérôme Benveniste, Expert, Committee on Space Research (COSPAR
POINTS DE REPÈRE
Abonnez-vous aux articles complets, publiés dans les newsletters, ou inscrivez-vous gratuitement au Fil info de l’agence de presse d’energiesdelamer.eu.
Avec l’abonnement (nominatif et individuel) l’accès est illimité à tous les articles publiés.
Abonnements : Aziliz Le Grand – Mer Veille Energie
Suivez-nous sur les réseaux sociaux Linkedin et Facebook
Le Business Directory est le répertoire des membres soutiens d’energiesdelamer.eu. Les adhésions des membres permettent l’accès gratuit aux articles publiés sur leurs activités par energiesdelamer.eu. Véritable outil de veille et de documentation, la database comprend 11 653 articles d’actualité qui ont été indexés quotidiennement, depuis août 2007.
Publicités Google :