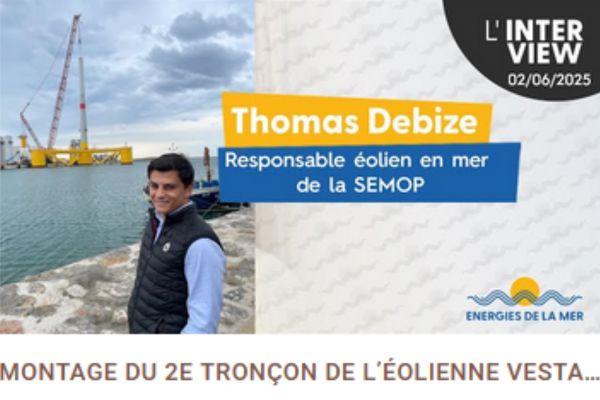France – 10/07/2025 – energiesdelamer.eu. Partie 1 –
Suivi et protection de la biodiversité marine, travail sur les usages, développement territorial, sécurité… Directrice de développement offshore d’Iberdrola France, Marie Thabard revient sur le travail qui a été accompli pendant la construction du parc éolien de Saint-Brieuc et depuis sa mise en service. Un travail qui fait appel à des dispositifs sophistiqués. Et qui contribue grandement à une meilleure connaissance du milieu marin.
En quoi a consisté votre action depuis le démarrage du chantier, en 2018, et alors que le parc de Saint-Brieuc fonctionne maintenant depuis un peu plus d’un an ?
Notre mission sur le parc nous offrait, à mon équipe et à moi-même, l’opportunité de poursuivre notre engagement en faveur de la transition énergétique, avec un projet innovant et qui présentait un fort ancrage territorial. Notre travail a porté sur trois aspects principaux : les usages, l’environnement et l’engagement en faveur du territoire.
Concernant les usages, le parc de Saint-Brieuc a été conçu de manière à permettre le maintien de la navigation et des activités de pêche au sein du parc, tant pour les arts traînants que pour les arts dormants. Depuis le 1er juillet 2024, les activités maritimes et de pêche ont repris dans le parc. Pour améliorer la coexistence entre les deux activités et faciliter les opérations du navire de maintenance, nous avons distribué aux pêcheurs plus de 1.200 bouées placées aux extrémités de leurs filets afin de favoriser leur identification, ainsi que des systèmes AIS, pour améliorer la sécurité en mer.
Cette année, le parc a été fréquenté plus de 140 jours par 90 navires de pêche tous métiers confondus, hormis la drague de coquilles Saint-Jacques, activité non ouverte dans le gisement du large à la demande des pêcheurs.
Le parc suscite également un intérêt touristique croissant. Depuis juillet 2024, les plaisanciers peuvent y naviguer librement. Des visites organisées par Les Vedettes de Bréhat et Les Corsaires de Saint-Malo ont permis à plus de 15 000 visiteurs de découvrir le site.

Départ des vedettes depuis l’embarcadère Arcouest

Fou de Bassan bagué – ©David Grémillet
Les mesures de suivis environnementaux se poursuivront durant toute sa phase d’exploitation, qui a débuté il y a plus d’un an. Quatre nouvelles mesures ont été mises en place en 2024, basées sur des technologies avancées – radar et caméras pour le suivi de l’avifaune, systèmes d’effarouchement d’oiseaux, dispositif de suivi des chiroptères, photo-identification des mammifères marins, ROV pour observer l’effet récif. Enfin, la sécurité en mer reste un point primordial, sur lequel nous avons beaucoup travaillé. Aucun incident maritime n’a été signalé, ce qui démontre la cohabitation harmonieuse entre les usages maritimes et les infrastructures du parc. Ainsi, la préfecture maritime de l’Atlantique a organisé dans le parc le premier exercice Orsec, les 7 et 8 octobre 2024. Nous avons également signé en février 2025 un partenariat officiel avec la SNSM, renforçant la coordination pour la sécurité en mer. Tout cela a nécessité un très important travail de concertation et d’échange. Nous avons participé à quelque 1.400 réunions officielles de concertation – sans parler des échanges informels !
On dit que le milieu marin se montre finalement très résilient…
En effet. Selon l’Ifremer, il n’y a jamais eu autant de coquilles Saint-Jacques dans la baie de St-Brieuc. La récolte 2025 a été exceptionnelle. Nos observations, à bord des navires de pêche et par ROV notamment, ont apporté des résultats rassurants sur la faune marine.
Y a-t-il un sujet sur lequel vous travaillez plus particulièrement aujourd’hui ?
Le parc étant désormais en phase d’exploitation, nos efforts de suivi se concentrent principalement sur la faune volante, notamment l’avifaune et les chiroptères (chauves-souris). Nous poursuivons également nos observations sur la faune marine, incluant les mammifères marins, les poissons, les crustacés et autres espèces. Dans ce cadre, nous avons déployé un ensemble d’équipements de surveillance : deux radars, des caméras, des enregistreurs acoustiques pour le suivi des chiroptères, ainsi que des dispositifs expérimentaux d’effarouchement d’oiseaux. Notre objectif est de multiplier les canaux d’information pour capter les signaux environnementaux et comprendre finement l’interaction des espèces avec le parc éolien.
« Le développement du parc de Saint-Brieuc a permis d’acquérir de nouvelles connaissances scientifiques, particulièrement utiles, sur le milieu marin »
Ces suivis se poursuivront sur plusieurs années. Ils alimentent une base de données robuste et inédite sur l’environnement marin de la baie de Saint-Brieuc. Le parc s’impose ainsi comme un véritable laboratoire scientifique en mer. Ces études permettent en effet de collecter des données scientifiques nouvelles et précieuses sur les écosystèmes marins locaux et la faune indigène. Elles contribuent de manière concrète à une meilleure connaissance de l’écosystème marin de la baie, en enrichissant les données bibliographiques et en mobilisant des institutions de recherche de premier plan.
Avez-vous collaboré avec des chercheurs de l’Université de Bretagne Occidentale (UBO) pour évaluer l’impact du parc et de son fonctionnement sur la biodiversité ? Pour quels résultats ?

Coquille Saint-Jacques instrumentée d’un valvomètre ©SOMME
Oui, Ailes Marines a ainsi soutenu les travaux de Mathilde Gigot en finançant les expérimentations en laboratoire (dans le cadre du projet IMPAIC) de sa thèse scientifique de doctorat (1). Cette thèse, financée par le CNRS, visait à évaluer l’incidence sonore d’origine anthropique sur les stades larvaires de deux espèces de bivalves, la coquille Saint-Jacques Pecten maximus et la praire Venus verrucosa, et plus particulièrement l’effet des bruits de battage et de forage sur les paramètres du développement larvaire.
Pouvez-vous citer un ou deux exemples concrets de vos découvertes ou apprentissages sur telle ou telle espèce, ou sur l’évolution du milieu marin, à l’occasion de la construction du parc ?
Le développement du parc de Saint Brieuc a généré de nombreuses externalités environnementales positives. Il a permis d’acquérir des connaissances scientifiques additionnelles, robustes et particulièrement utiles sur le milieu marin. Ainsi une thèse de doctorat a été publiée dans le cadre d’un projet de recherche piloté par des chercheurs du Muséum national d’histoire naturelle et du CNRS sur la coquille Saint-Jacques et le bruit. Des capteurs de stress ont été brevetés. Ils ont permis de préciser le rythme biologique méconnu jusqu’alors de cette espèce locale emblématique.
Les instruments de mesures installés en mer pendant près de 4 années nous ont également permis de suivre l’évolution du milieu, et notamment le réchauffement des masses d’eau. Toutes ces données sont précieuses pour mieux comprendre le fonctionnement de la baie et alimenter les réflexions locales. L’Office français de la biodiversité (OFB) a par exemple bénéficié d’un partage de connaissances sur les oiseaux et mammifères marins, implémentant de ressources documentaires nouvelles le document d’objectifs du site Natura2000.
Comment fonctionnent le suivi et la concertation avec les autorités et les différentes parties prenantes ?
Depuis la phase de construction du parc, Iberdrola a mis en œuvre des programmes de suivi environnemental renforcé, en collaboration avec les autorités, des instituts de recherche et des associations. Sur les 40 mesures de suivi environnemental, 19 concernent la phase d’exploitation.
La gouvernance du parc est organisée par le préfet des Côtes d’Armor. Plusieurs arrêtés préfectoraux ont été pris pour organiser le suivi du parc. Deux instances ont été mandatées : un comité de gestion et de suivi et un conseil scientifique. Le comité de suivi, réuni 2 fois par an durant la construction et désormais une fois par an en phase d’exploitation, peut s’appuyer autant que de besoin sur le conseil scientifique, ou même parfois des expertises tierces. Ceci a été le cas pour le parc de Saint-Brieuc : ce comité scientifique a remis des avis sur plusieurs protocoles scientifiques, l’Ifremer, le Cerema et le Shom ont été missionnés pour des contre-expertises et des avis. Un avis de l’Ifremer souligne d’ailleurs la qualité de nos protocoles de suivi : « Les “marées expérimentales” telles que proposées par les maîtres d’ouvrage sont suffisantes pour détecter un éventuel impact du parc et de son raccordement sur les espèces halieutiques ciblées », peut-on y lire.
Propos recueillis par Jean-Claude Lewandovski
(1) Intitulée “Caractérisation de l’impact acoustique des travaux de battage et de forage associés aux constructions éoliennes offshores sur les stades larvaires des bivalves marins Pecten maximus et Venus verrucosa”, cette thèse a été réalisée sous la direction de Laurent Chauvaud (LEMAR), Julien Bonnel (WHOI) et Frédéric Olivier (BOREA).
POINTS DE REPÈRE
Abonnez-vous aux articles complets, publiés dans les newsletters, ou inscrivez-vous gratuitement au Fil info de l’agence de presse d’energiesdelamer.eu.
Avec l’abonnement (nominatif et individuel) l’accès est illimité à tous les articles publiés.
Abonnements : Aziliz Le Grand – Mer Veille Energie
Suivez-nous sur les réseaux sociaux Linkedin et Facebook
Ailes Marine – Iberdrola France est membre du Business Directory, le répertoire des membres soutiens d’energiesdelamer.eu. Les adhésions des membres permettent l’accès gratuit aux articles publiés sur leurs activités par energiesdelamer.eu. Véritable outil de veille et de documentation, la database comprend, depuis le 15 juin 2025, plus de 10 800 articles d’actualité qui ont été indexés quotidiennement.
Publicités Google :